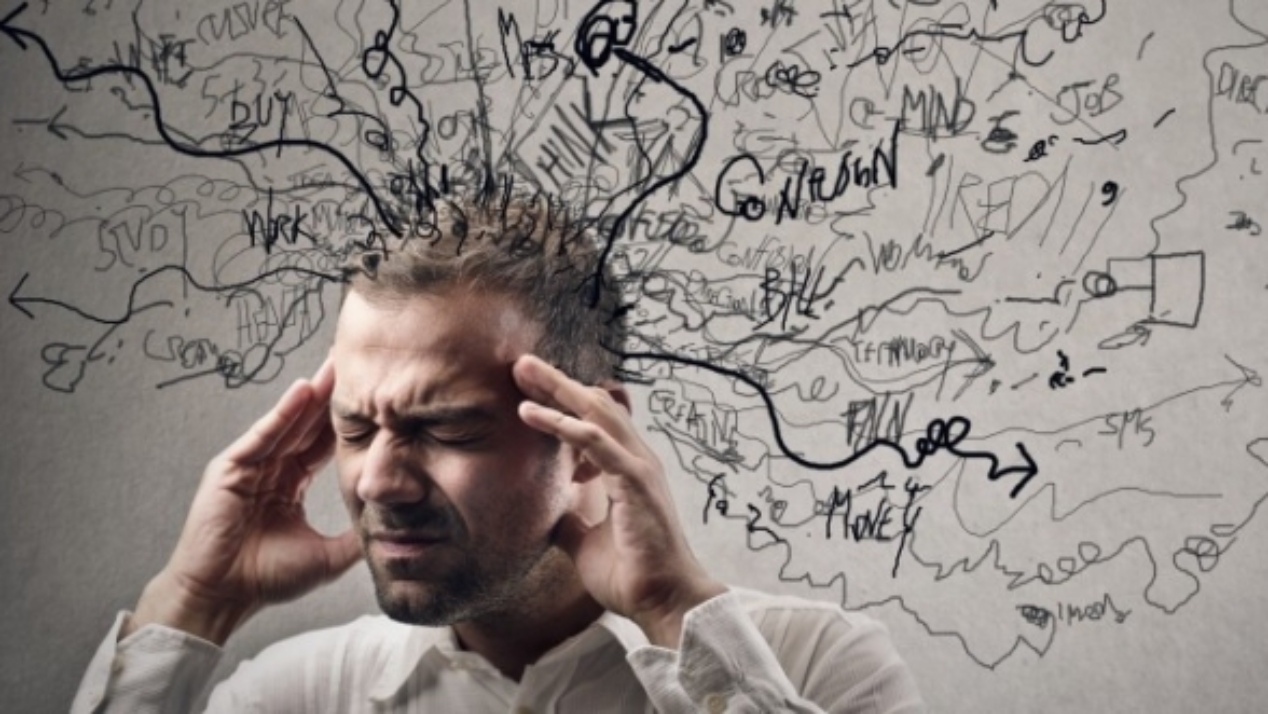La légalisation de la mort provoquée, qu’il s’agisse de l’euthanasie ou du suicide assisté, soulève une tension essentielle : celle entre la variabilité du désir de mourir et l’irréversibilité de l’acte létal. Cette tension engage une réflexion sur la nature du consentement en situation de vulnérabilité, sur le rôle du soin et sur les conditions d’un choix réellement libre.
1. La fluctuation du désir de mort : une réalité empirique
De nombreuses études cliniques ont montré que le souhait de mourir chez des patients gravement malades ou en fin de vie est rarement constant. Il varie souvent en fonction de la qualité de l’accompagnement, du soulagement de la douleur, du soutien psychologique ou de l’environnement social. Ces expressions, lorsqu’elles sont prises en compte avec une réponse adéquate – médicale, psychologique, spirituelle ou relationnelle – peuvent être réversibles.
Par ailleurs, une revue de la littérature montre que la majorité des patients en soins palliatifs qui expriment un désir de mourir ne maintiennent pas ce souhait dans le temps, surtout lorsqu’un accompagnement pluridisciplinaire est mis en place. Ces éléments soulignent la nécessité de ne pas interpréter la demande de mort comme un indicateur stable, mais plutôt comme un marqueur de détresse psychique ou existentielle.
2. Légalisation et enfermement décisionnel
Légaliser la mort provoquée revient à introduire une possibilité d’action institutionnellement encadrée sur la base d’un consentement individuel. Or, lorsque ce consentement est exprimé dans un contexte de vulnérabilité, la stabilisation légale de cette possibilité peut transformer une parole fluctuante en trajectoire inéluctable.
Ce phénomène, parfois désigné comme un slippery slope décisionnel, a été observé dans certaines juridictions ayant légalisé l’euthanasie, où l’élargissement progressif des critères et la banalisation du processus ont conduit à des dérives documentées. Même en présence de garde-fous, il est difficile de garantir que la décision finale émane d’un consentement pleinement libre et réversible.
3. Une anthropologie du soin en tension
La légalisation repose sur une anthropologie libérale de l’autonomie, dans laquelle le sujet est considéré comme rationnel, cohérent et apte à faire des choix éclairés. Or, cette conception est mise en question par les approches relationnelles du soin, qui insistent sur l’interdépendance, l’émotion et la temporalité des décisions en fin de vie.
Plutôt que de penser le soin comme un simple respect de l’autonomie formelle, certains auteurs plaident pour une éthique de la sollicitude (care), qui vise à maintenir le lien, à accompagner la souffrance et à préserver la possibilité d’un retournement intérieur. Dans cette perspective, proposer la mort comme solution risque de rompre le sens même de la relation thérapeutique.
L’analyse de la tension entre la variabilité du désir de mort et l’irréversibilité de la mort provoquée montre une faille fondamentale dans l’argumentaire en faveur de la légalisation. Loin de garantir une autonomie pleine et entière, cette légalisation risque d’enfermer des individus vulnérables dans une décision non réversible, prise à un moment de détresse. Une éthique véritablement humaine exige de construire des réponses qui soutiennent la vie jusque dans sa fragilité, plutôt que de la clore prématurément au nom d’un choix qui peut n’être que l’expression d’une solitude non entendue.
Bibliographie
- Ariès, P. (1977). L’Homme devant la mort. Paris : Seuil.
- Breitbart, W., Rosenfeld, B., Pessin, H., et al. (2000). “Depression, Hopelessness, and Desire for Hastened Death in Terminally Ill Patients with Cancer.” JAMA, 284(22), 2907–2911.
- Chochinov, H.M., Hack, T., Hassard, T., Kristjanson, L.J., McClement, S., & Harlos, M. (2002). “Dignity in the Terminally Ill: A Developing Empirical Model.” Social Science & Medicine, 54(3), 433–443.
- Cohen-Almagor, R. (2002). Euthanasia in the Netherlands: The Policy and Practice of Mercy Killing. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
- Emanuel, E.J. (1999). “What is the Great Benefit of Legalizing Euthanasia or Physician-Assisted Suicide?” Ethics, 109(3), 629–642.
- Gilligan, C. (1982). In a Different Voice: Psychological Theory and Women’s Development. Cambridge: Harvard University Press.
- Jones, D.A., & Paton, D. (2015). “How Does Legalization of Physician-Assisted Suicide Affect Rates of Suicide?” Southern Medical Journal, 108(10), 599–604.
- Ricoeur, P. (1992). Soi-même comme un autre. Paris : Seuil.
- Tronto, J. (1993). Moral Boundaries: A Political Argument for an Ethic of Care. New York: Routledge.