
Nous, psychologues, psychiatres et psychanalystes, nous indignons face à une incohérence majeure : comment peut-on prétendre prévenir le suicide tout en légitimant, dans certains cas, la mort provoquée ? Ce double discours est éthiquement et cliniquement insoutenable, et politiquement incohérent.
Comment soutenir nos patients contre la pulsion de mort qui les traverse, tout en validant que, pour certains, le passage à l’acte serait une solution ?
En autorisant l’euthanasie et le suicide assisté, la société envoie un message terrible : certaines vies ne mériteraient plus d’être vécues. Pour ceux qui vacillent déjà, ce signal peut suffire à les faire basculer. C’est une ligne rouge que nous ne devons pas franchir. En tant que psys, notre rôle est précisément d’aider les personnes en détresse à retrouver leur place dans le monde, à ne pas céder au sentiment d’inexistence ou au désir d’exclusion.
Légaliser la mort provoquée, c’est affirmer qu’il existe deux types de souffrances : celles qui méritent un accompagnement et celles qui justifieraient l’élimination de celui qui souffre. Cette logique est une bombe à retardement pour la prévention du suicide. Comment convaincre une personne désespérée de s’accrocher à la vie si la société elle-même admet que, dans certains cas, la mort est une issue légitime ?
Chaque jour, nous recevons des patients persuadés que leur souffrance est sans issue. Notre mission est de leur montrer qu’il existe des moyens de l’apaiser, de redonner du sens à leur existence. Si la mort provoquée devient une option légale, elle enverra un message contradictoire : alors que nous luttons pour détourner nos patients du suicide, la société leur dira que, dans certains cas, leur disparition est acceptable. Ce paradoxe fragilise notre travail et érode la confiance de ceux qui cherchent une issue à leur détresse.
Nous, psychologues et psychiatres, dénonçons un double discours intenable : d’un côté, on investit dans la prévention du suicide ; de l’autre, on envisage de légaliser l’euthanasie. C’est une contradiction brutale. Comment prétendre protéger la vie tout en validant, dans certains cas, l’idée que la mort serait une solution ? En autorisant le suicide assisté, on introduit un message toxique : certaines vies ne mériteraient plus d’être vécues. Pour ceux qui vacillent déjà, ce signal peut suffire à faire basculer. C’est une ligne rouge que nous ne devons pas franchir.
Chaque jour, nous écoutons des personnes convaincues que leur souffrance est sans issue. Notre rôle est de les aider à percevoir qu’il existe des moyens de soulager leur souffrance et de reconstruire un sens à leur vie. Si l’euthanasie devient une option légale, elle enverrait un signal contradictoire : alors que nous encourageons ces personnes à ne pas céder à leurs pensées suicidaires, la société leur dirait en parallèle que, dans certains cas, mettre fin à sa vie est une solution légitime. Cette incohérence fragilise notre message et érode la confiance de ceux qui cherchent une issue à leur détresse.
Légaliser l’euthanasie, c’est entériner l’idée que certaines détresses sont compatibles avec la vie, quand d’autres seraient si intolérables qu’il vaudrait mieux en finir. C’est une rupture profonde avec l’éthique du soin. Cette logique est une bombe à retardement pour la prévention du suicide. Comment soutenir l’espoir chez ceux qui vacillent, si notre société érige en solution la possibilité d’en finir ?
Nous le savons, nous le voyons : le désespoir est un état temporaire, une traversée douloureuse, mais jamais une fatalité. Nous avons vu des patients, hier en larmes et accablés, retrouver espoir et reconstruire leur vie. Mais combien, si l’euthanasie devient un droit, abandonneront avant même d’avoir eu cette chance ? Combien de personnes fragiles, âgées, malades ou simplement en souffrance, sentiront peser sur elles cette pression invisible les poussant à renoncer ?
Dans notre pratique, nous savons que ce qui retient une personne au bord du vide, ce n’est pas une logique froide de droits ou de procédures, mais la chaleur d’un lien, d’un regard, d’une présence. La pensée suicidaire, bien que profonde, est souvent ambivalente. Elle appelle autant à la fin qu’au secours. C’est précisément dans cet interstice que l’amour des proches, l’attention du cercle familial et amical, les soins et les paroles des professionnels viennent jouer leur rôle de dissuasion. Mais qu’adviendra-t-il de cette chaîne humaine, lorsque la loi offrira une voie d’euthanasie discrète, rapide, encadrée, hors du regard de ceux qui auraient pu encore aimer, retenir, aider ? Le suicide, devenu médicalisé, pourrait désormais échapper à ceux qui jusqu’ici pouvaient encore intervenir, consoler, convaincre de rester.
Nous assistons déjà à un renversement préoccupant : dans le cadre d’une tentative de suicide, le réflexe médical, éthique et social est aujourd’hui de tout mettre en œuvre pour préserver la vie. C’est un acte de société : sauver est un devoir. Demain, avec la nouvelle législation, un geste désespéré pourrait être interprété non plus comme un appel à vivre, mais comme une manifestation claire d’un “choix de mort” qu’il conviendrait d’honorer en poursuivant l’acte jusqu’à son terme, par euthanasie. Nous glisserions alors vers une société qui ne cherche plus à retenir, mais à valider, voire à faciliter. Une société qui, au lieu de répondre par la main tendue, répondrait par l’aiguille. Une société qui, par cohérence légale, pourrait renoncer à lutter contre la mort quand celle-ci se présente sous le voile du consentement.
Nous refusons ce basculement. Les psychologues s’engagent au contraire dans une œuvre d’encouragement à vivre, en mobilisant tout ce qui restaure le lien, la dignité, l’écoute, l’espoir, souvent au moment même où la personne n’y croit plus. Laisser croire que certaines souffrances justifient qu’on abdique tout effort d’accompagnement, c’est trahir l’idéal même du soin.
Ne nous y trompons pas : ce n’est pas un « droit » que nous donnons aux plus vulnérables, c’est un fardeau. Un poids terrible qui leur fera croire que leur vie est un poids pour les autres. Qui les privera du regard compatissant et des mains tendues qui auraient pu les sauver.
Nous sommes à un tournant crucial. Plutôt que de valider l’abandon, investissons dans l’accompagnement. Offrons des soins palliatifs de qualité, des ressources en psychiatrie, un accès réel à des psychologues compétents et disponibles. Ne laissons plus personne choisir la mort par manque de soutien, par isolement, par désespoir.
Nous implorons les parlementaires et le gouvernement : ne laissons pas l’euthanasie détruire ce que nous avons construit pour la prévention du suicide. Nous devons rester fidèles à ce qui nous définit en tant que société : la solidarité, l’humanité, et l’espoir inébranlable qu’aucune vie ne doit être abandonnée.
Nous serons toujours aux côtés de ceux qui souffrent. Nous refuserons toujours de leur tourner le dos. Ne légalisons pas la mort administrée qui touchera d’abord ceux qui nous sont confiés.
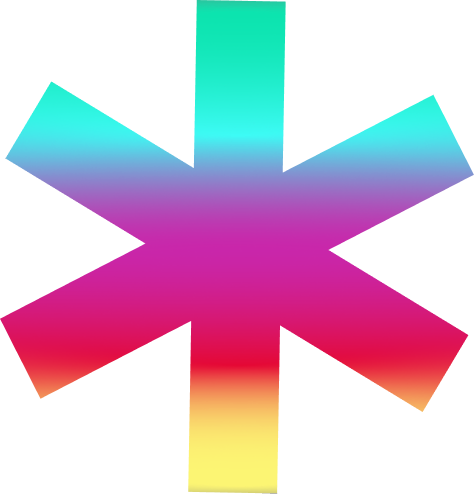

Psychiatre hospitalier, responsable médical VigilanS 78-95

Psychiatre, praticienne hospitalière, Paris

professeur de psychiatrie, présidente de l’Association Française de Psychiatrie Biologique

Psychiatre, lanceur d'alerte

Professeure de psychologie sociale Université Sorbonne Paris Nord

Psychiatre de la personne âgée

Chef du service hospitalo-universitaire de psychiatrie du CHU de Brest

Professeur de psychiatrie à Lille, coordonnateur national du 31 14

Psychologue clinicienne, psychanalyste

Gerontopsychiatre APHP et Docteur en Philosophie et éthique médicale
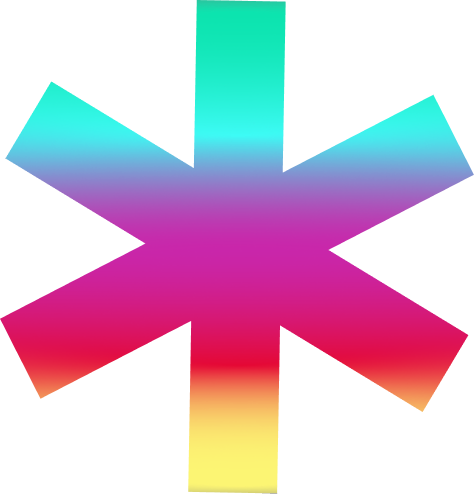

Psychiatre hospitalier, responsable médical VigilanS 78-95

Psychiatre, praticienne hospitalière, Paris

professeur de psychiatrie, présidente de l’Association Française de Psychiatrie Biologique

Psychiatre, lanceur d'alerte

Professeure de psychologie sociale Université Sorbonne Paris Nord

Psychiatre de la personne âgée

Chef du service hospitalo-universitaire de psychiatrie du CHU de Brest

Professeur de psychiatrie à Lille, coordonnateur national du 31 14

Psychologue clinicienne, psychanalyste

Gerontopsychiatre APHP et Docteur en Philosophie et éthique médicale

Chef du service de Psychiatrie d’Adultes du CHU de Lille & du Secteur 59G08
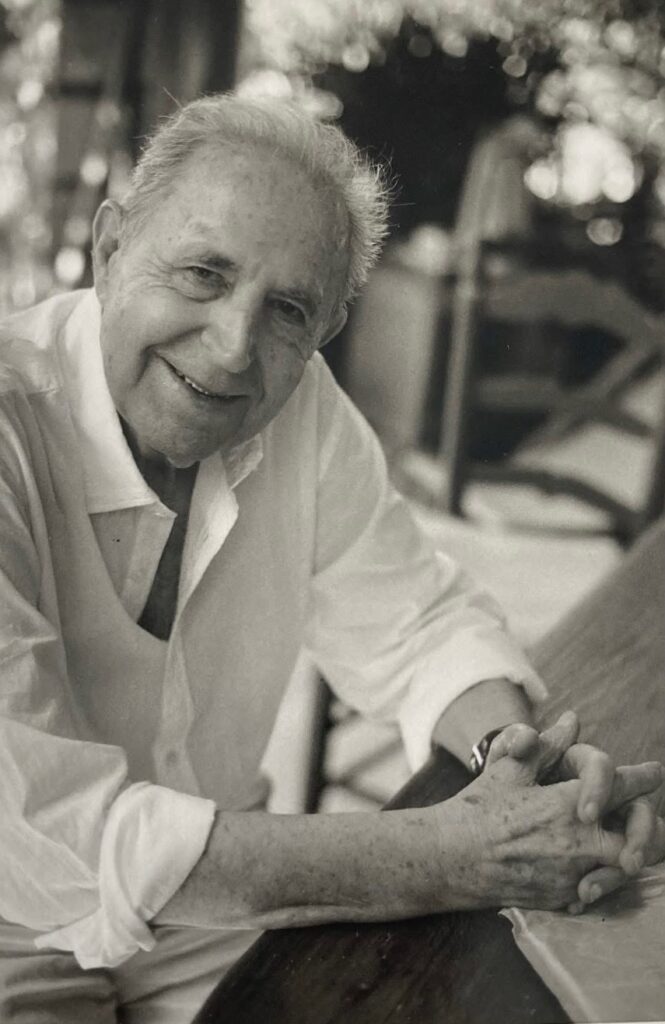
Psychanalyste et universitaire. Professeur émérite de psychologie et de psychopathologie clinique

Psychiatre, chef de pôle à l’hôpital Sainte-Anne, GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences

Psychologue clinicienne, Réanimation et Equipe Mobile de Soins Palliatifs Centre Hospitalier de Saint Denis

Psychiatre-psychanalyste, chercheure associée à la Chaire de Philosophie à l'Hôpital et doctorante en philosophie
SANDRA LOJOWSKI, Psychiatre / LUCILE GRUAU, Psychologue, Psychologue USP/EMSP / LAURENT MARULAZ, Psychiatre, PH temps plein / HÉLÈNE PRIEST, Profession, Psychologue clinicienne / MICHAEL ROBIN, Psychiatre, Libéral / RAPHAELLE MATTA, Psychologue / GUILLAUME MOREL, Psychiatre, Interne / ISABELLE BRIMBEUF, Profession, FPH / CLÉMENCE PERROT, Psychiatre, Praticien Hospitalier / CASSANDRE LANDEL, Psychiatre, Praticien Hospitalier / ISABELLE DELAGE, Psychiatre / AURELIE MARTINEZ, Psychologue, Psychologue clinicienne en SP / LORRAINE SIBOUT, Psychologue / LAURE GONTARD, Psychiatre, Chef de pôle GHU / NATHALIE BUCLET, Psychologue, Psychologue / VAN MÔ DANG, Autre professionnel de santé, Praticien Hospitalier en Gériatrie / LAETITIA HOUDOYER, Psychologue, Psychologue à l’EN / MARINE RAIMBAUD, Psychiatre, PH / MAGALI FIX, Psychologue / STÉPHANIE NGUYEN, Psychologue, Psychologue clinicienne / ALESSANDRA MAPELLI, Psychologue, Psychologue clinicienne …
