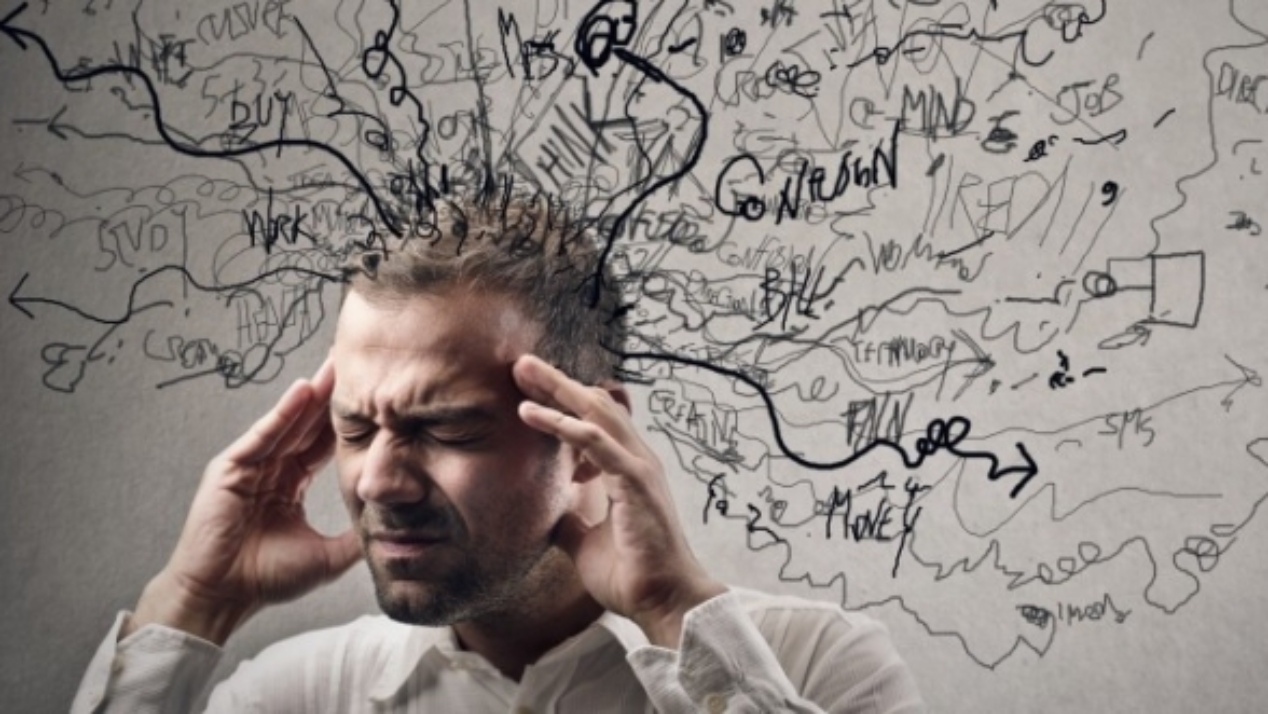Peut-on à la fois légaliser une forme de mort volontaire encadrée par l’État et continuer à promouvoir une politique rigoureuse de prévention du suicide ? Dans leurs fondements, objectifs et conséquences, tout oppose ces deux démarches.
1. Deux logiques opposées : soulager ou sauver
La mort administrée repose sur un principe de compassion : il s’agit de permettre à une personne, généralement atteinte de souffrances physiques ou psychiques jugées intolérables et durables, de mettre fin à sa vie de manière encadrée et sécurisée, souvent par l’intervention directe d’un professionnel de santé.
La prévention du suicide, quant à elle, repose sur un principe fondamental : toute vie mérite d’être protégée, et le suicide est toujours une tragédie à éviter. Elle mobilise des efforts médicaux, psychologiques, sociaux et institutionnels pour dissuader, intervenir et soutenir les personnes en détresse.
La contradiction devient évidente : dans un cas, la société agit pour empêcher une personne de mourir ; dans l’autre, elle organise, encadre, voire facilite cet acte.
2. Quels critères pour distinguer les deux ?
Les partisans de la légalisation soutiennent que la différence essentielle réside dans le consentement éclairé et la présence d’une souffrance réfractaire. Selon eux, la mort administrée ne s’adresse pas à tous, mais seulement à ceux pour qui il n’existe plus d’alternative acceptable.
Mais cette distinction est fragile. En effet :
- De nombreuses personnes suicidaires affirment aussi vivre une souffrance intolérable, souvent psychique.
- Les troubles mentaux peuvent altérer la perception du réel et du désespoir, rendant difficile d’évaluer le caractère « libre et éclairé » d’une demande de mort.
- La frontière entre euthanasie pour souffrance physique (considérée légitime) et suicide lié à la détresse psychologique (considéré illégitime) devient floue, voire arbitraire.
3. Effets sociaux et symboliques préoccupants
La coexistence des deux approches peut produire des effets paradoxaux :
- Affaiblissement du message social : Si la société envoie simultanément le message que « la vie vaut toujours la peine d’être vécue » (prévention du suicide) et qu’« il peut être légitime de mettre fin à sa vie dans certaines conditions » (euthanasie), cela peut troubler les repères éthiques et psychologiques des individus en souffrance.
- Risque de contagion suicidaire : la littérature suggère que la banalisation d’une forme de mort volontaire peut induire un effet d’imitation, en particulier chez les personnes vulnérables.
- Glissement des critères : Certains pays ayant légalisé la mort administrée (comme les Pays-Bas ou la Belgique) ont vu, avec le temps, l’élargissement des critères d’accès, incluant parfois des troubles mentaux chroniques.
4. Vers une contradiction irréconciliable ?
Le cœur du problème réside peut-être dans une tension philosophique irréductible : la prévention du suicide affirme que le désir de mourir est toujours un symptôme à traiter, tandis que la légalisation de la mort administrée admet que ce même désir peut être lucide, rationnel et digne d’être exaucé.
Certains proposent une voie intermédiaire : renforcer les garanties éthiques, médicales et juridiques, limiter strictement l’accès à l’aide à mourir, tout en réaffirmant vigoureusement l’engagement contre le suicide. Mais cette position reste difficile à maintenir sans contradiction logique ou morale.
L’incompatibilité entre la légalisation de la mort administrée et la prévention du suicide ne se résume pas à un simple débat de politique publique. Elle révèle une fracture plus profonde : celle entre deux visions du rôle de la société face à la souffrance et à la mort.